Mardi 05 Février 2019
Dossier : Aux actes, citoyens !
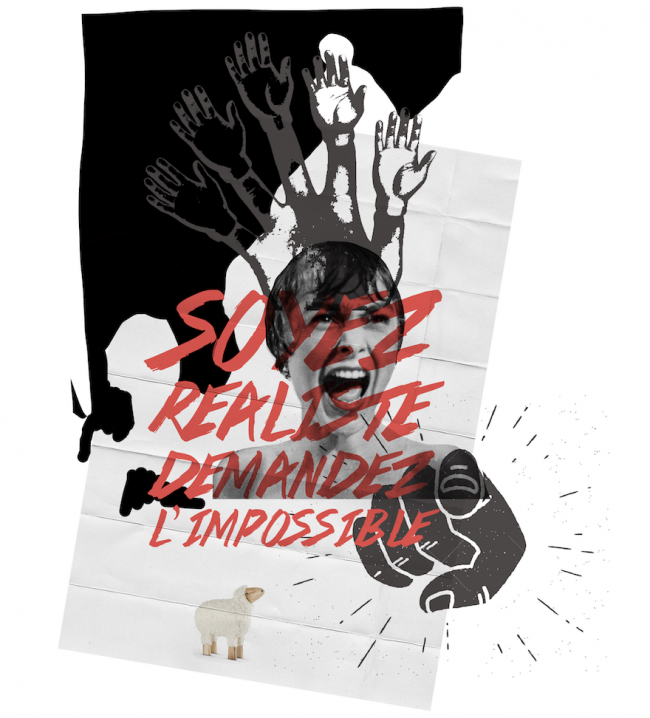
L’état de la planète vous exaspère, les inégalités vous font bondir et le manque global de bon sens vous atterre ? Que vous soyez débonnaire ou révolutionnaire, tartine de tapenade plutôt que barricades, une seule solution : se remonter les manches et passer à l’action. On vous propose 5 options pour ne plus jamais vous entendre dire « gna gna gna de toute façon rien ne changera jamais ».
Pétition : j'écris mon nom
Si certaines revendications ont été « écoutées » (l’interdiction du glyphosate d’ici 3 ans n’a cependant pas été inscrite dans la loi), d’autres sont restées sans suite : la loi travail est passée en force avec le recours au 49.3 malgré la pétition et les nombreuses manifestations, et la directive sur le secret des affaires a été adoptée par le parlement européen, deux semaines seulement après les révélations des « Panama Papers ».
Heureusement, d’autres pétitions ont su se faire entendre, comme celle concernant le chalutage profond, qui a bénéficié du soutien de la dessinatrice Pénélope Bagieu, ou la grâce présidentielle de Jacqueline Sauvage, soutenue par des manifestations. Pour lutter, la pétition en ligne ne constitue donc pas nécessairement une fin en soi, mais permet d’ajouter du poids à une revendication relayée par ailleurs. Plus récemment, la pétition de Priscillia Ludosky intitulée « Pour une baisse des prix du carburant à la pompe ! », signée par plus d’un million de personnes, a marqué le point de départ de la mobilisation des « gilets jaunes ».
Pour aller un peu plus loin sans pour autant quitter le confort de votre canapé, vous pouvez prendre part au lobbying citoyen. Le lobby « classique » pratiqué par les entreprises privées consiste à soumettre aux élus des propositions de loi et des amendements en leur faveur. Certains sites de lobbying citoyen vous permettent, à vous aussi, d’interpeller directement votre sénateur pour lui soumettre des amendements.
Vive la societe de consomm-action
Le boycott est le mode privilégié d’expression des français (43%, selon le baromètre de la confiance politique cevipof – opinionway). Décider, à votre échelle, de lutter contre une marque ou une organisation en les privant de vos précieux deniers, voilà un moyen simple et non violent de traduire son mécontentement. On se souvient notamment du boycott des produits Danone, soutenu par ses propres salariés, lorsque la marque annonçait vouloir supprimer 3 000 postes, et ce malgré d’excellents résultats, ou encore celui de la marque Nutella, suite aux propos de Ségolène Royale dénonçant la destruction des forêts tropicales pour la production d’huile de palme. Ces deux exemples ont en commun de s’être soldés par un échec : les salariés de Danone ont bel et bien été licenciés, et les pots de Nutella sont toujours les stars des supermarchés. Pas assez suivis, ou sur une trop courte période, le résultat est clair : aucun boycott n’a fait s’écrouler une marque.
Mais, est-il sans intérêt pour autant ? Par le prisme d’une marque, c’est généralement une question plus globale qui est portée à l’attention du grand public, qu’il s’agisse de dénoncer des problèmes écologiques, d’inégalités ou de cruauté animale. Le boycott peut ainsi remettre en question des manières de consommer, et amener les citoyens à opter pour des solutions alternatives, en achetant des produits locaux ou en circuits courts, ou en privilégiant le prêt ou l’occasion, par exemple.
Ainsi, depuis le lancement de la première Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) en 2001, les fermes qui vendent directement leur production aux consommateurs en court-circuitant la grande distribution n’ont cessé de se développer, grâce à une clientèle toujours plus engagée. Résultat, la France est aujourd’hui la championne d’Europe de l’agriculture bio en circuit court, et 21 nouvelles fermes bio sont créées chaque jour.
#OnDitToo
Votre témoignage peut contribuer à faire avancer votre cause, même si, soyons honnête, une prise de position du côté des « people » est souvent plus efficace.Cela a été le cas pour le « Manifeste des 343 » (liste de 343 personnalités françaises ayant eu recours à l’avortement alors qu’il était illégal en 1971, parmi lesquelles Simone de Beauvoir et Catherine Deneuve) ou plus récemment du côté d’Hollywood avec le mouvement « #metoo », largement relayé par les célébrités, qui s’engagent de plus en plus sur la toile. Mais ce n’est pas parce que vous êtes un illustre inconnu que votre témoignage ne peut pas faire avancer les choses !
Via internet et les réseaux sociaux, leviers incontournables de toutes les revendications, vous pouvez diffuser votre message en postant des statuts, ou en partageant pétitions, vidéos, articles ou résultats d’études. Si vous parvenez à convaincre ne serait-ce que quelques personnes, vous aurez déjà mené une action de sensibilisation. Que ce soit pour dénoncer une inégalité ou pour témoigner d’une violence, la libération de la parole permet aussi de sortir les victimes de leur isolement. Récemment, les nombreux témoignages concernant le harcèlement scolaire ont permis la mise en place d’études et d’actions de sensibilisation massivement relayées sur internet. Si c’est finalement peu de choses, c’est toujours mieux que rien. Et qui sait, à force de témoignages et de sensibilisation, les mentalités pourraient bien finir par évoluer.
La rue est à vous
Y a pas à dire, occuper l’espace reste un bon moyen de se faire voir, et entendre. Même si on peut observer que les appels à mobilisations ponctuels lancés par les syndicats et partis traditionnels ne créent plus vraiment d’émules, on a constaté ces dernières années que les mouvements citoyens d’occupation de places de longue durée ont, eux, pris de l’ampleur.
On se souvient d’ « Occupy Wall Street » aux États-Unis (à l’été 2011, plusieurs milliers de personnes occupaient la bourse new-yorkaise pour dénoncer les abus du capitalisme financier), des « Indignés » en Espagne (et un peu partout, également en 2011), de « #YoSoy132 » au Mexique (mouvement étudiant de 2012 visant à défendre la liberté d’expression et le droit à l’information), du « Mouvement des parapluies »à Hong-Kong (qui s’oppose, en 2014, au gouvernement chinois, qui envisageait de limiter le suffrage universel), etc.
Si les revendications portées par ces citoyens dépendent bien sûr du contexte de chaque pays, on pourrait y trouver certaines similitudes, et notamment la défense de la démocratie, de l’environnement et de la dignité humaine, ou encore la lutte contre les inégalités et la corruption. En filigrane, on y lit une remise en question de la démocratie représentative, qui ne semble plus représenter grand monde, et de la collusion entre élites politiques, économiques et médiatiques.
Ainsi, la question d’une démocratie participative et horizontale revient régulièrement dans les assemblées.
En bref, les citoyens veulent apporter des solutions concrètes en s’investissant dans des initiatives de solidarité locale et d’économie solidaire. Si le mouvement « Occupy Wall Street » n’a définitivement pas faitbouger les lignes, en Espagne, les « Indignés » gagnent du terrain.
Et en France ? À l’heure où nous écrivons ces lignes, les « Gilets Jaunes » poursuivent leur occupation. Même si, comme nous l’explique Sylvie Ollitrault à la fin de ce dossier, ce mouvementne s’inscrit pas exactement dans la lignée des mouvements des places, on y retrouve plusieurs similitudes : une mobilisation récurrente, indépendante de tout parti, et dont les racines sont multiples.
Parti de la contestation d’une taxe, c’est finalement l’injustice fiscale et écologique, et le mépris exprimé par les classes dirigeantes qui semblent cristalliser les colères. Le 8 décembre dernier, revendications économiques et écologiques marchaient ainsi coude à coude, avec des slogans comme « Pas de justice climatique sans justice sociale » ou « Fin dumonde, fin du mois, même combat ». Reste, maintenant, à savoir de quelle manière les choses vont évoluer.
Le temps, c'est de l'engagement
S’engager, ce n’est pas nécessairement manifester.
En France, il existe plus d’un million d’associations, qui mobilisent environ 25 % des citoyens, parmi lesquels une grande proportion de jeunes. Chiffre étonnant, alors que les générations y ou z sont souvent injustement dépeintes comme blasées et fondamentalement autocentrées. Plusieurs sondages révèlent, en effet, le pessimisme des 18-34 ans vis-à-visde l’avenir, leur défiance envers la politique, les institutions et les médias, le tout teinté d’une profonde colère (62% d’entre eux déclarent pouvoir participer à un grand mouvement de révolte)*.
Mais ce n’est pas parce que les jeunes ne font pas confiance aux pouvoirs publics pour changer les choses qu’ils ont renoncé à passer eux-mêmes à l’action. Ainsi, ils n’hésitent pas à donner de leur temps pour s’investir dans des collectifs et des associations.
Depuis 2010, l’engagement citoyen des moins de 35 ans ne cesse de progresser et aujourd’hui, un jeune français sur cinq est bénévole dans une association. L’idée : avoir un réel impact à l’échelle locale, et permettre, grâce à son action, d’aider ceux qui en ont besoin et de lutter contre les inégalités. Plutôt que de soutenir des syndicats et partis traditionnels, nombreux sont ceux qui font le choix du terrain : distribuer des repas, faire du soutien scolaire, participer à des actions de sensibilisation à l’environnement, organiser des événements pour récolter des fonds, etc. Décider de donner une heure ou deux de son temps par semaine, c’est déjà faire la différence.
Vous vous dites peut-être que c’est bien joli, tout ça. On vous arrête tout de suite : oui, on sait qu’il y a une urgence climatique et que très peu de décisions fortes sont prises pour renverser la vapeur. On sait, aussi, qu’il existe des inégalités insupportables, des gens qui accaparent les richesses et les ressources sans se soucier du reste, des gens qui ont faim alors que des tonnes de nourriture partent à la poubelle... Et que ce n’est pas vous, avec vos petits bras et vos petites jambes, qui allez sauver le monde. Mais s’il n’y a pas de petits engagements, il y a, par contre, zéro engagement ! Donnez-vous un peu de crédit et souvenez-vous de ce que disait le Dalaï Lama : « Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez lequel des deux empêche l’autre de dormir. »
*Enquête « Génération What » réalisée auprès de 210 000 personnes âgées de 18 à 35 ans
Sylvie Ollitrault : "Les mobilisations par les réseaux vont se généraliser"
Directrice de recherche en Sciences Politiques au CNRS, Sylvie Ollitrault a étudié les questions de l’expression de la radicalité et de désobéissance civile. Elle nous éclaire aujourd’hui sur l’engagement de la jeunesse, et sur le mouvement des « gilets jaunes », toujours mobilisés au moment de cette rencontre.
par ces mouvements.
la manière de s’organiser, mais aussi dans le fond, c’est-à-dire dans les revendications ?
On individualise plus les revendications, et c’est aussi ce qui fait la difficulté des « gilets jaunes », chacun a un cas particulier. C’est très différent de l’époque où il y avait des grandes idéologies à peu près formatées, portées par les partis politiques par exemple.
Avec les « gilets jaunes », ce n’est pas tout à fait la même chose, même s’ils ont aussi des grandes idées, ils ont moins de capacité à formuler un discours plus général. Ils défendent des positions plutôt que des grandes idées. D’ailleurs, des partis comme les Insoumis récupèrent les revendications des « gilets jaunes » pour davantage les théoriser, notamment sur la question du déclassement social par exemple. Mais il se peut, même si je ne sais pas ce qu’il va se passer, qu’un discours plus général se construise dans le temps.

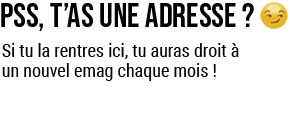



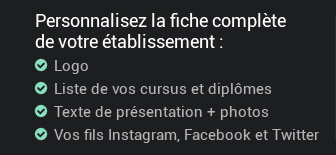
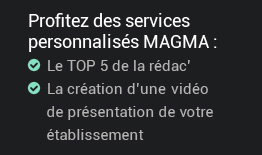


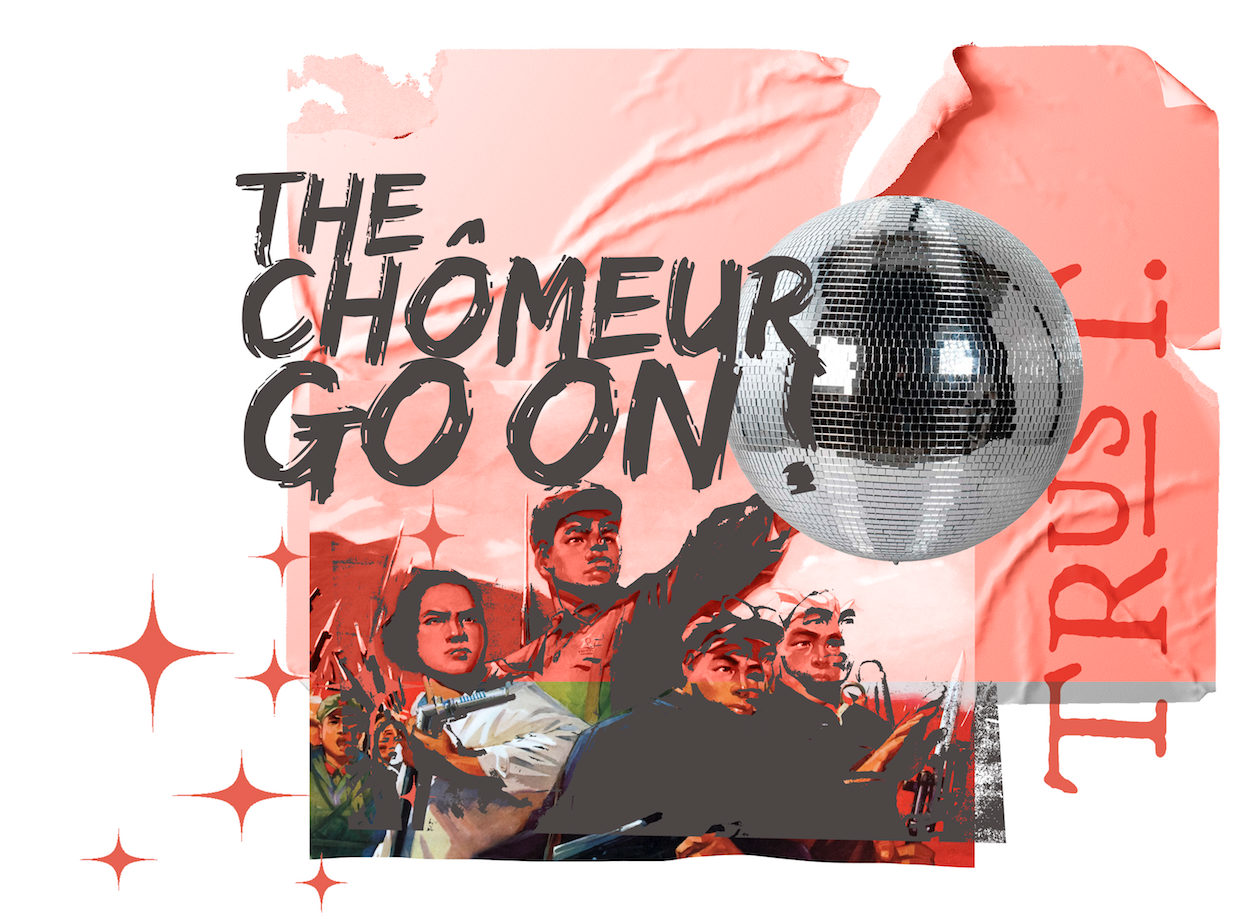
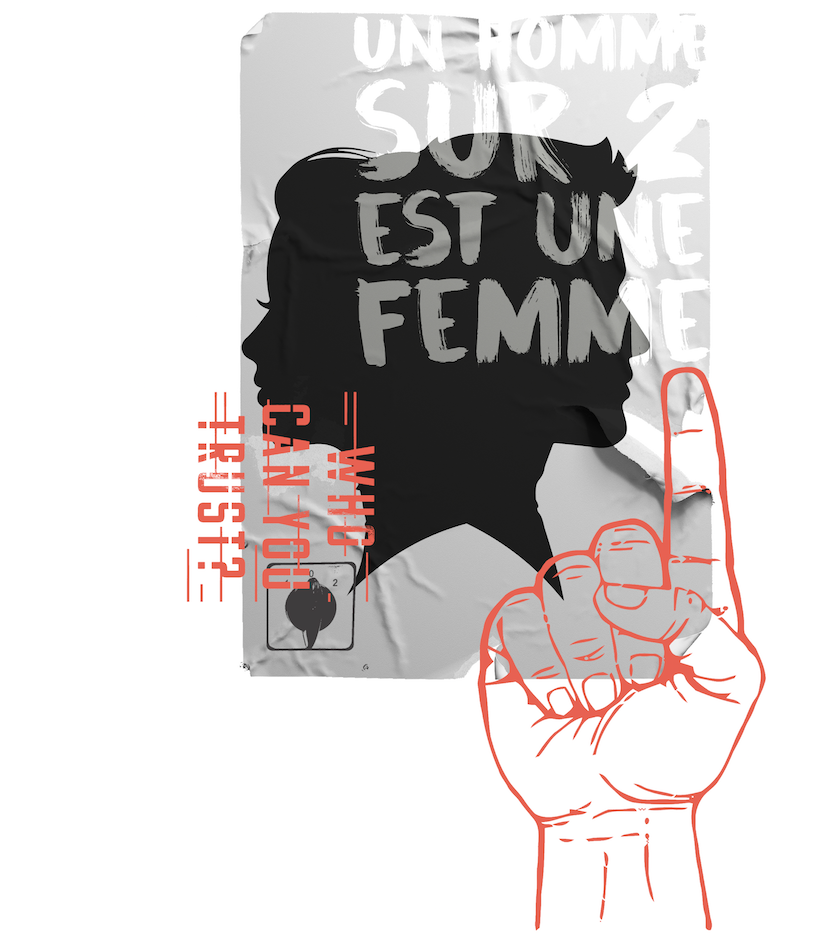
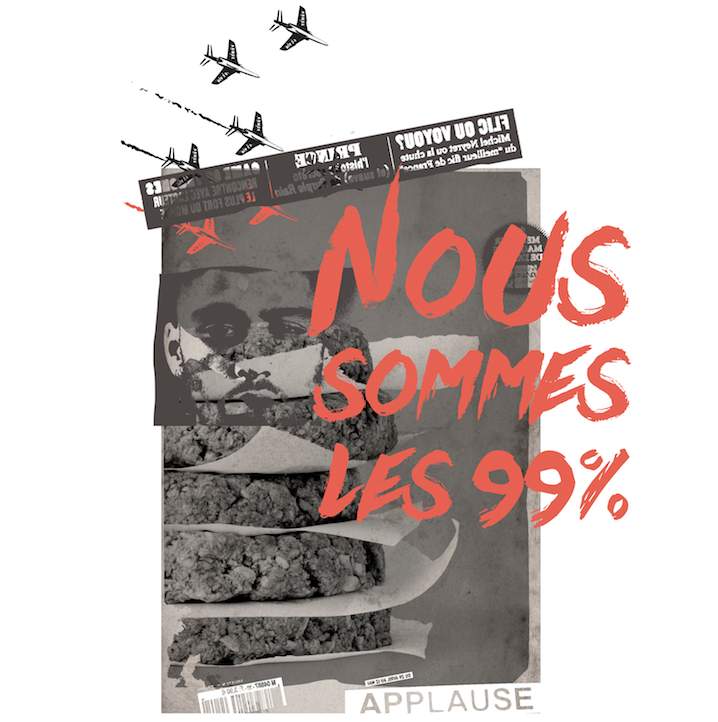



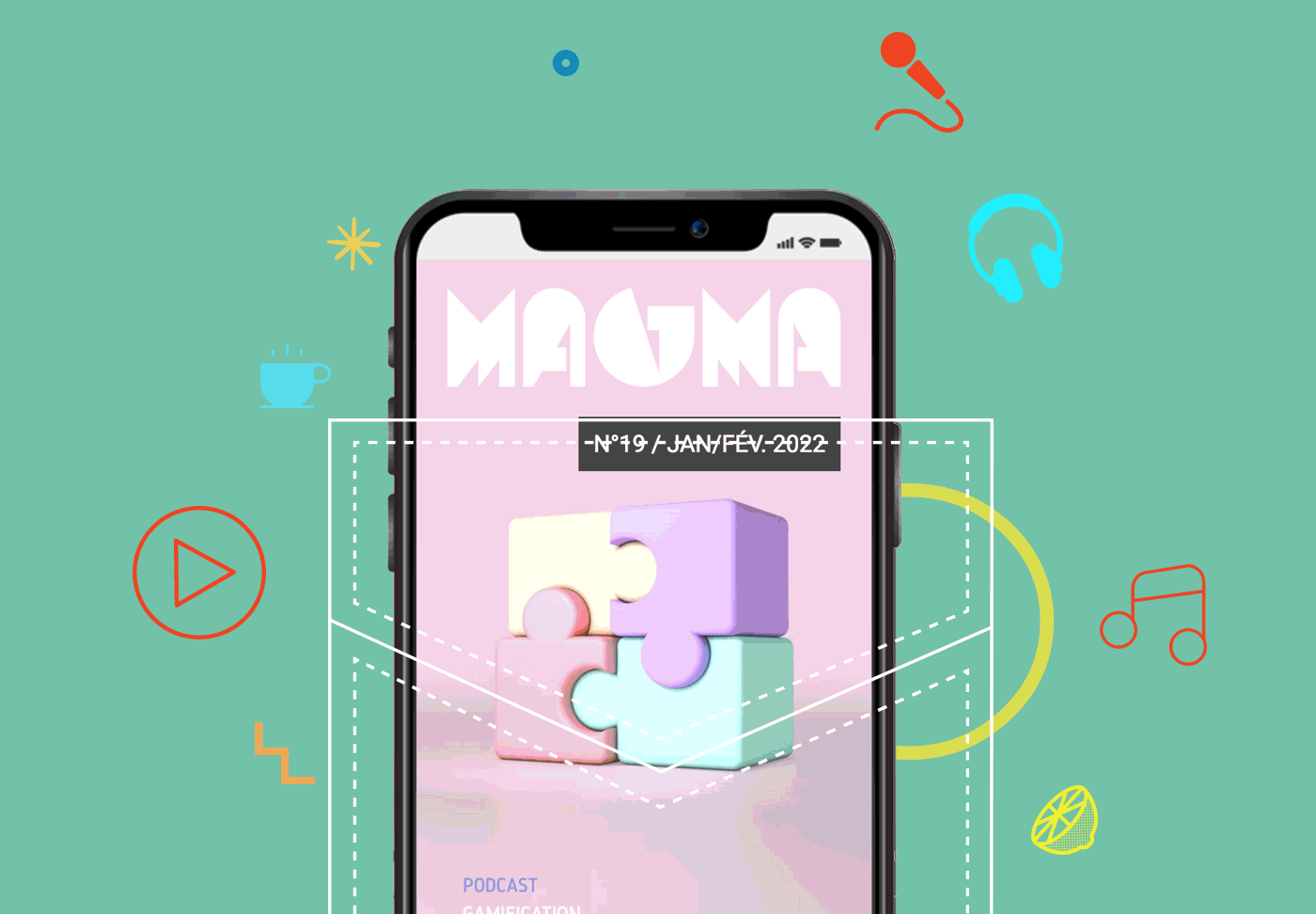










Partagez cet article